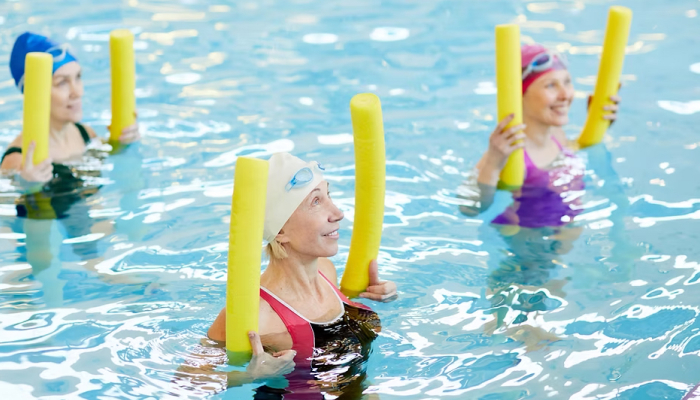Grâce aux progrès de la médecine et de la technologie, nous vivons en moyenne beaucoup plus longtemps que par le passé. C’est une réussite qui vient avec d’autres soucis, comme l’augmentation du nombre de problèmes de santé susceptibles d’entraîner des conséquences, dont la perte d’autonomie. Il est donc important de bien se préparer, d’aborder le sujet dans toute sa complexité avec ses proches, et surtout, de dépasser les préjugés.
Vieillir fait partie de la vie, et nous vivons dans une société qui l’oublie souvent. Le déni est cependant une très mauvaise approche. Comment faire pour que cette transition se fasse le plus sereinement possible? Comment bien accompagner nos parents vieillissants dans cette réalité? On en discute avec Jocelyne Lévesque, directrice générale du Marronnier.

Entretenir une relation respectueuse avec ses parents
Ce n’est pas un mythe: plusieurs personnes âgées et retraitées se montrent réticentes à recevoir l’aide de leurs proches lorsqu’elles font face à une perte d’autonomie. Ancrée dans la peur de la personne d’être déracinée de son milieu de vie, sa crainte de devenir dépendante d’autrui et son souhait de rester aux commandes de son existence, cette réticence peut toutefois être prévenue ou du moins atténuée. Comment? En cultivant au fil des années une relation fondée sur le respect.
«Souvent, on s’éloigne de nos parents à partir du moment où ils prennent leur retraite», explique Mme Lévesque. «On est pris dans nos propres vies, on leur rend visite pour les occasions spéciales, mais on n’est pas impliqué dans leur quotidien. C’est souvent lorsqu’un des parents tombe malade que tout à coup les enfants prennent conscience qu’ils doivent être plus présents.»
Dans ces cas-là, dire à son proche qu’il n’est plus apte à s’occuper de lui-même et qu’il doit accepter de l’aide peut être intrusif. «On entend souvent “Pourquoi j’aurais besoin d’aide? Ça fait des années que je m’organise. Tu ne viendras pas me dire quoi faire!” Les proches doivent donner du temps aux parents afin qu’ils comprennent et acceptent chacune des nouvelles étapes à venir ainsi que l’aspect irréversible de la situation.»
La clé : la préparation
Pour éviter ce genre de situation, la préparation est primordiale. Autrement dit, il faut agir en amont, avant que la personne soit confrontée à une perte d’autonomie concrète. Et comment fait-on pour bien se préparer? La présence, l’écoute, le dialogue et la recherche d’information.
«Quand on est en réaction, il est beaucoup plus difficile de parler avec notre cœur. Nos parents ne souhaitent pas qu’on se fasse du souci pour eux et sont prêts à faire certains compromis», assure la directrice générale de la résidence. «Il ne faut pas hésiter à leur communiquer que nous sommes inquiets pour eux et que le stress généré par la situation devient une charge lourde à porter au quotidien. Si le lien de proximité a été entretenu et le dialogue amorcé en amont, dans la bienveillance et sans jugement, tout se passe beaucoup plus facilement.»

La perte d’autonomie : le dernier des tabous
Au même titre que la mort, et peut-être même plus encore, la perte d’autonomie qui accompagne le vieillissement est un grand tabou dans les conversations. Tant que nos parents sont bien portants, la pensée magique que tout va bien aller nous habite. Pourtant, le déni ne fait qu’empirer la situation en repoussant l’inévitable.
Être à l’écoute et engager la discussion
«Il est important d’amorcer tôt un dialogue avec ses proches. On peut poser des questions du genre “Si tu devais aller à l’hôpital demain matin et que tu avais besoin d’aide à ton retour à la maison, comment voudrais-tu que ça se passe? Accepterais-tu que quelqu’un entre chez toi pour s’occuper de ton entretien ménager?” Il se peut très bien que la personne refuse d’envisager ce scénario sur le coup, mais la réflexion va faire son bout de chemin. On commence tranquillement à susciter des questionnements.»
Si la personne se braque à la première approche, il est préférable de laisser passer un certain temps avant de revenir sur le sujet. Il y a fort à parier qu’elle cogitera de son côté, réalisant qu’il vaut mieux y songer plus tôt que tard, et qu’elle fera preuve de plus d’ouverture lors d’un prochain échange.
En revanche, si la personne s’ouvre, il faut lui permettre de s’exprimer. «Par exemple, si elle dit “Si quelque chose m’arrivait, voici ce que je souhaiterais”, on pourrait être tenté de répondre “Mais non voyons, t’es en forme, arrête de dire ça”, mais ce n’est pas ce dont la personne a besoin. Elle nous fait part de ses inquiétudes, et même si on n’est pas prêt à les entendre, c’est notre rôle, en tant qu’enfant, d’entretenir ce lien qui lui permet d’exprimer ses craintes. Parce que ça peut être inquiétant de vieillir.»
Être au-devant des besoins
Comme Mme Lévesque le rappelle, l’aide des enfants ou des proches est primordiale, même si plusieurs personnes âgées ont tendance à refuser pour ne pas déranger. «C’est bien d’aller au-devant des besoins et que l’aide soit déjà présente avant qu’elle ne soit nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de heurter le sentiment d’indépendance et d’autonomie du parent.»
La peur de déranger leurs proches dans leur vie bien remplie habite parfois les personnes âgées qui ne souhaitent pas devenir un fardeau. Un petit coup de pouce improvisé apporté avec tact et délicatesse peut alors s’avérer précieux.
Comme le nombre de personnes âgées sans enfants est en hausse constante, les proches qui accompagnent les aînés dans ces étapes de la vie ne sont pas nécessairement leurs enfants biologiques. Neveux, nièces, amis peuvent alors jouer ce rôle d’accompagnement.

Aborder la situation de manière positive
Plusieurs personnes âgées vivent avec l’angoisse d’être «placées». Dans leur esprit, les maisons de ressources sont des mouroirs où l’on renonce au bien-être. C’est le rôle des proches de les accompagner tout en les rassurant. «Accepter qu’on est en perte d’autonomie, ce n’est pas se diriger vers le mouroir», affirme Mme Lévesque. «Au contraire, c’est pouvoir se prémunir de ressources qui vont nous aider à bien vivre le plus longtemps possible. Lorsque la perte d’autonomie s’installe, il est parfois difficile de prévoir jusqu’où elle ira.»
En s’informant adéquatement sur les options existantes, il est possible de présenter plusieurs scénarios à son parent en perte d’autonomie. Pour ce faire, il ne faut pas hésiter à consulter le personnel médical, qui possède les compétences nécessaires pour bien orienter ses patients. «Il n’y a pas qu’une seule issue où l’on se dirige fatalement. Le fait de communiquer le plus tôt possible à son parent les avenues et les ressources à sa disposition va le rassurer. Si son médecin traitant estime que la mise en place d’un dispositif d’aide est nécessaire, il saura trouver les mots justes et la bonne approche pour bien guider la famille, devenant ainsi un précieux allié.»
Vivre le mieux possible, le plus longtemps possible
Tout le monde ne sera pas confronté à une perte d’autonomie au cours de sa vie. Au Marronnier, plusieurs personnes terminent leur vie paisiblement et demeurent dans leur appartement jusqu’à la fin. «Mais il faut se préparer et envisager certains scénarios», affirme la directrice générale. «On ne sait jamais ce qui peut arriver, et il est important de choisir avec soin les batailles à mener. Avant toute chose, il est important de déterminer si la sécurité est en jeu, et si vous jugez que les décisions de vos parents ne sont pas éclairées, n’hésitez pas à demander conseil à un professionnel de la santé.»
Dans les situations critiques, les gens sont bien souvent démunis. N’attendons pas d’être confrontés à ce type de situation pour en parler et élaborer un plan! La préparation et l’information sont les clés du succès.
Vous aimerez aussi :
Perte d’autonomie temporaire en résidence : doit-on déménager?
Les bienfaits de manger en groupe pour les aînés
Le bon moment pour déménager en résidence